(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Recherche
(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Enews Legipresse
Le club Légipresse
Vidéos
Infractions de presse (Janvier 2018 – Décembre 2018)
La présente synthèse traite des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse, ainsi que de certaines infractions ne relevant plus de cette loi, le législateur ayant manifesté l'intention, contestée par certains, de durcir leur répression. Il s'agit d'un panorama non exhaustif des décisions rendues, l'intérêt primant sur le nombre. Le lecteur sera toutefois mis en garde sur le caractère non définitif de certaines décisions, information, il est vrai, capitale mais qui n'était pas en notre possession au jour de la publication des présentes. Cette année jurisprudentielle nous semble marquée, d'une part, par un renforcement du particularisme du droit de la presse dans lequel prime le formalisme et l'interprétation stricte des principes de la loi de 1881, au risque d'une possible rupture avec la tentation victimiste d'une partie de la société civile. D'autre part, l'interventionnisme législatif en la matière tend à s'affirmer, au risque cette fois d'une possible atteinte au droit à l'information des citoyens sur des sujets d'intérêt général. Nous ne pouvons qu'encourager les magistrats, les avocats, les associations, et plus généralement ceux qui font œuvre de justice, à résister pour maintenir la protection de la liberté d'expression, enjeu fondamental dans nos sociétés démocratiques.
La présente synthèse traite des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse, ainsi que de certaines infractions ne relevant plus de cette loi, le législateur ayant manifesté l'intention, contestée par certains, de durcir leur répression. Il s'agit d'un panorama non exhaustif des décisions rendues, l'intérêt primant sur le nombre. Le lecteur sera toutefois mis en garde sur le caractère non définitif de certaines décisions, information, il est vrai, capitale mais qui n'était pas en notre possession au jour de la publication des présentes. Cette année jurisprudentielle nous semble marquée, d'une part, par un renforcement du particularisme du droit de la presse dans lequel prime le formalisme et l'interprétation stricte des principes de la loi de 1881, au risque d'une possible rupture avec la tentation victimiste d'une partie de la société civile. D'autre part, l'interventionnisme législatif en la matière tend à s'affirmer, au risque cette fois d'une possible atteinte au droit à l'information des citoyens sur des sujets d'intérêt général. Nous ne pouvons qu'encourager les magistrats, les avocats, les associations, et plus généralement ceux qui font œuvre de justice, à résister pour maintenir la protection de la liberté d'expression, enjeu fondamental dans nos sociétés démocratiques.
Etude
I – Le périmètre de la loi du 29 juillet 1881
A – Liberté d'expression et norme européenne
1 – Expression protestataire
Dans un contexte de recul du multilatéralisme aux États-Unis et en Europe, et de contestation de la légitimité des juridictions supranationales, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a rendu, au cours de l'année, plusieurs décisions au visa de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme dont seules certaines seront examinées ici. La Cour sanctionne fréquemment la répression par les États de l'expression d'une protestation politique, domaine dans lequel leur marge de manœuvre est particulièrement limitée. D'aucuns sauront trouver dans ces décisions qui ne concernent pas directement la France un écho au climat politique qui y règne.
Dans une première décision du 13 mars 2018, la Cour a jugé que la condamnation à l'équivalent de jours-amendes de deux personnes pour avoir brûlé, en 2007, une photographie du couple royal d'Espagne en critique de la monarchie constituait une violation de l'article 10 de la Convention (CEDH, 3e sect., 13 mars 2018, nos 51168/15 et 51186/15, Stern Taulats et Roura Capellera c/ Espagne).
Toujours en Espagne, la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie du cas d'un activiste délogé par la force par deux policiers au cours d'une occupation d'un centre social et qui dénonçait dans la presse un « acte de torture ». Condamné pour diffamation par les juridictions internes au motif que les actes de contrainte subis ne caractérisaient pas l'infraction de torture prévue en droit pénal, la Cour européenne considère, au contraire que le terme « torture » est employé dans un sens familier et non juridique par le requérant, pour formuler un jugement de valeur, c'est-à-dire l'expression de son ressenti, dans le cadre d'un débat d'intérêt général relatif à l'utilisation de la force par les policiers (CEDH 20 nov. 2018, no 26922/14, Toranzo Gomez c/ Espagne).
Une troisième décision de condamnation concernant la sanction d'une expression protestataire, a été rendue contre la Russie, gros pourvoyeur d'affaires pour la Cour européenne pour violation notamment de l'article 10 du fait de la condamnation à des peines de prison et du blocage des vidéos montrant les membres des Pussy Riot investissant une cathédrale moscovite. La Cour relève que les juridictions n'ont pas justifié leurs décisions de condamnation à des peines de prison ni de blocage des contenus. Selon elle, seuls des appels à la violence ou à la haine auraient pu justifier de telles sanctions pénales, ce qui ne ressort nullement de l'analyse des juridictions internes, qui se sont basées uniquement sur le comportement des requérantes et non sur les paroles de leur chanson. À noter que dans ce dossier la Russie a également été condamnée sur le fondement des articles 3 (Interdiction de la torture) 5 (Droit à la liberté et à la sûreté) et 6 (Droit à un procès équitable) (CEDH 17 juill. 2018, no 3804/12, Mariya Alekhina et A. C. Russie).
2 – Incitation à la haine religieuse
Un État peut légitimement apporter des restrictions à la liberté d'expression lorsque des propos sont susceptibles d'une part d'inciter à la haine ou à l'intolérance religieuse et d'autre part porter atteinte à la liberté de conscience et de religion. Les États disposent, en effet, en la matière d'une marge d'appréciation plus importante compte tenu du contexte et de la situation dans le pays où les propos sont formulés, et dans le but légitime de préserver la paix religieuse.
Ainsi, ne viole pas l'article 10 de la Convention le fait pour les juridictions internes de condamner à une amende de 480 € une conférencière et responsable d'un parti politique qui, au cours d'une conférence, imputait des actes de pédophilie au prophète Mahomet, même sous forme interrogative. La Cour rappelle à cette occasion la distinction devant s'opérer entre déclarations factuelles et jugements de valeur, les seconds ne pouvant faire l'objet d'une preuve de la vérité. Cependant, faisant application du principe de proportionnalité, un jugement de valeur manquant de base factuelle suffisante peut s'avérer excessif et partant contrevenir à un des droits protégés par la Convention. En l'espèce les propos de la requérante manquaient d'objectivité et d'éléments historiques pour démontrer l'existence d'un échange ou d'un débat sur le sujet et, au contraire, visaient à établir péremptoirement que le prophète était indigne d'être vénéré. Ces déclarations outrepassaient ainsi les limites de la liberté d'expression (CEDH 25 oct. 2018, no 38450/12, E.S. c/ Autriche(1)).
3 – Immunité de l'avocat en dehors du prétoire
Dans une précédente synthèse, il était fait état de plusieurs décisions de la Cour relatives à la protection de la liberté d'expression de l'avocat dans et en dehors du prétoire (CEDH, gr. ch., 23 avr. 2015, Morice c/ France(2) ; CEDH, 4e sect., 30 juin 2015, Peruzzi c/ Italie(3) ; CEDH 15 déc. 2015, Bono c/ France(4)).
Cette année, c'est une nouvelle fois la France qui a été condamnée par la Cour sur le fondement de l'article 10 de la Convention, du fait d'une sanction disciplinaire prononcée contre un avocat qui avait tenu, une fois sorti d'une cour d'assises, des propos remettant en cause l'origine ethnique d'un jury « majoritairement blanc ». La Cour ne va pas jusqu'à remettre en cause la règle selon laquelle l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut recevoir application qu'au sein d'une salle d'audience, mais rappelle que, s'agissant d'un débat d'intérêt général, la marge d'appréciation des États est limitée de telle sorte qu'une condamnation ne pouvait être prononcée qu'avec la plus extrême vigilance. En l'espèce, l'avocat disposait, en outre, d'une base factuelle suffisante pour formuler un jugement de valeur, élément de la défense de son client, sur la composition du jury (CEDH 19 avr. 2018, n° 41841/12, Ottan c/ France(5)).
B – Liberté d'expression et norme constitutionnelle
1 – Impossibilité pour un État de poursuivre en diffamation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881
Un État, qu'il soit Français ou étranger, ne peut engager de poursuite en diffamation car il ne saurait être assimilé à un particulier au sens de l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881. C'est ce que rappelle la Cour de cassation qui a refusé de transmettre des QPC sur ce point. Pour la Cour il n'en résulte aucune atteinte disproportionnée au principe du droit à un recours juridictionnel effectif, les responsables et représentants de l'État conservant le droit de demander réparation, sur le fondement de l'article 32, alinéa 1er, précité, du préjudice résultant d'une allégation ou imputation portant atteinte à leur honneur ou leur considération (Crim. 27 mars 2018, no 17-84.509, Le Royaume du Maroc ; Crim. 6 févr. 2018, no 17-83.857, La République d'Azerbaïdjan).
2 – QPC sur les articles 421-2-5, 422-3 et 422-6 du code pénal réprimant l'apologie du terrorisme
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une QPC portant sur les articles 421-2-5, 422-3 et 422-6 du code pénal réprimant l'apologie du terrorisme et relative à la conformité de ces dispositions avec le principe de légalité des délits et des peines, la liberté d'expression et le principe de nécessité et de proportionnalité des peines. Cette décision était très attendue des juristes spécialisés, les uns déplorant que des qualifications pénales relatives à des écrits ou propos soient exclues de la loi sur la presse tandis que les autres s'en félicitaient du fait de l'importance de la sanction en résultant. Le Conseil écarte les critiques formulées à l'égard des dispositions visées et les déclare conformes à la Constitution. Il considère, en effet, que l'infraction est définie de façon suffisamment précise et non équivoque s'agissant du comportement et de l'intention incriminés, écartant de ce fait le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines, le Conseil estime que l'aggravation prévue dans les cas où le délit a été commis en ligne ainsi que les peines complémentaires ne sont pas manifestement disproportionnées au regard de la nature et de la gravité des comportements visés. Enfin, le Conseil décide que le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public en instituant ces infractions qu'il entend prévenir. L'apologie publique, par la large diffusion des idées et propos dangereux qu'elle favorise, créé par elle-même un trouble à l'ordre public. Les actes de terrorisme dont l'apologie est réprimée sont des infractions d'une particulière gravité susceptible de porter atteinte à la vie ou aux biens, justifiant ainsi leur insertion dans le code pénal et donc la mise à l'écart de la loi du 29 juillet 1881. L'atteinte portée à la liberté d'expression et de communication par les dispositions contestées est donc nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur et le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté finalement rejeté (Cons. const. 18 mai 2018, no 2018-706 QPC, M. Jean-Marc R.(6) – transmission de la QPC, Crim. 27 févr. 2018, no 17-81.381, Jean-Marc X.(7)).
C – Liberté d'expression et actualités législatives
Cette année encore, l'inflation législative dans le domaine du droit de l'information se confirme. En premier lieu, la proposition de loi relative à la protection du secret des affaires(8) a suscité la mobilisation des journalistes et associations de défense des droits humains qui considéraient le texte incompatible avec la liberté d'expression et le droit à l'information du public(9). Une fois adoptée, la loi a fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel, par laquelle les requérants reprochaient au texte de porter une atteinte disproportionnée à la liberté de communication, au journalisme d'investigation, à la protection des sources et à la protection accordée aux lanceurs d'alerte. Dans sa décision no 2018-768 DC du 26 juillet 2018, le Conseil a déclaré la loi conforme à la Constitution et rejeté les critiques des parlementaires. Le Conseil rappelle toutefois le contexte particulier de la transposition d'une directive limitant son pouvoir d'appréciation.
Ainsi, le secret des affaires a d'ores et déjà permis de justifier la rétention d'informations dans le cadre d'investigations par des journalistes, sur des questions pouvant présenter des enjeux de santé publique. En particulier, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a rejeté une demande d'un journal, qui dans le cadre d'une enquête sur les carences des contrôles des dispositifs médicaux, tendait à obtenir la liste des dispositifs médicaux certifiés par la société habilitée à le faire en France. Paradoxalement, si c'était en vertu d'une directive européenne que le législateur français a transposé le « secret des Affaires », c'est également au niveau européen que se sont multipliés en 2018, les appels à la protection des journalistes, notamment contre les poursuites bâillons, dans un contexte européen très marqué par plusieurs scandales liés à des meurtres de journalistes enquêtant sur des affaires de corruption. En France, l'année 2018 a également été marquée par la mobilisation de journalistes et d'associations contre le phénomène des poursuites bâillons, notamment au sein du collectif « On Ne Se Taira Pas ».
Autre source d'inquiétude pour la liberté d'expression et la protection du travail des journalistes, la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information qui, on le rappelle, créé une nouvelle voie de référé civil visant à faire cesser la diffusion de « fausses informations » durant les trois mois précédant un scrutin national. Cette loi a également été validée par le Conseil constitutionnel, qui a tout de même assorti sa décision de quelques réserves d'interprétation. Tout d'abord, s'agissant de la procédure de référé visant à faire cesser la diffusion de certains contenus, une telle mesure ne pourra être justifiée que si le caractère inexact ou trompeur desdits contenus, ou si le risque d'altération de la sincérité du scrutin est « manifeste ». L'analyse du Conseil est la même s'agissant de l'article 6 de la loi, qui permet au CSA de suspendre la diffusion de fausses informations sur des services de radio et de télévision contrôlés par un État étranger ou placés sous son influence. Cette loi a été beaucoup critiquée en raison de son « inutilité » du fait de l'existence d'autres fondements juridiques aptes selon ses détracteurs à répondre tout aussi efficacement à l'objectif fixé. Si elle résulte d'une volonté des gouvernements successifs de répondre à un besoin de la société civile et politique d'une protection renforcée sur internet et les réseaux sociaux dans le but de limiter les effets néfastes de diffusions de fausses informations, la multiplication de textes ne fait qu'accentuer la complexité de la matière.
D – Distinction entre dénigrement et diffamation
Une personne morale s'estimant atteinte par des propos portant le discrédit sur son activité commerciale et plus précisément la qualité des services qu'elle propose peut engager une action en dénigrement de produits ou services, fondée sur le droit commun de l'article 1240 (anc. 1382) du code civil. Si une certaine incertitude a pu un temps subsister quant au périmètre exact de cette action par rapport à celle engagée pour diffamation, la jurisprudence est aujourd'hui établie : elle ne présente pas de caractère subsidiaire mais recouvre des situations différentes.
La Cour de cassation a ainsi eu cette année l'occasion de rappeler, tout d'abord, que les imputations de faits précis, constitutifs d'infractions pénales ou décrivant des comportements illicites visant une société et non ses produits et services, portent atteinte à son honneur ou à sa considération. La réparation de telles atteintes ne peut dès lors être recherchée que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 (Com. 26 sept. 2018, no 17-15.502, Sté Gibmedia ; v. égal. Crim. 19 juin 2018, no 17-82.526, Vincent X. et Yohan Y.).
À l'inverse la Cour juge tout aussi constamment que les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale. Le dénigrement de produit, s'il advient fréquemment dans des situations de concurrence, ne s'y limite pas comme l'a rappelé récemment la Cour de cassation, le périmètre de cette action, se trouve ainsi étendu (Civ. 1re, 11 juill. 2018, no 17-21.457).
II – Diffamation publique
A – Publicité
Un tract comportant des propos violents et péremptoires, distribués dans la cour d'un hôpital, lieu public accessible à tous les usagers, répond à la condition de publicité dans la mesure où il n'a pas été distribué aux seuls personnels de l'hôpital liés par une communauté d'intérêt mais à n'importe quel usager ou passant (Crim. 10 avr. 2018, no 17-80.315, Véronique X.).
B – Imputation de faits précis
Ne renferme l'imputation d'aucun fait précis le tract d'une association distribué et diffusé sur un réseau social décernant le « prix de l'indignité républicaine, catégorie pire préfecture de France » au secrétaire d'une préfecture en raison de son « hostilité envers l'idée de l'amélioration de l'accueil des étrangers ». Ces propos, formulés dans le cadre d'une libre appréciation critique sur l'action d'une personne prise en sa qualité de fonctionnaire public ne contiennent pas d'articulation de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire. Ils ne traduisent qu'une opinion, laquelle, on le rappelle, ne peut faire l'objet d'une preuve et de ce fait, ne peut recevoir la qualification de diffamation. Ce n'est que lorsque le jugement de valeur se transforme en attaque personnelle que la sanction devient possible (Crim. 9 janv. 2018, no 17-80.502, M. C. Y.).
De même, les propos d'une chanson de rap faisant allusion aux goûts de luxe d'un élu, à des pratiques policières douteuses, à la mafia, à une situation de non-droit, n'imputent aucun fait précis à l'homme politique en question et ne peuvent faire l'objet d'une preuve compte tenu de leur généralité (Crim. 27 févr. 2018, no 17-81.123, C. Estrosi et A.).
Au contraire, dans le cas d'articles imputant à une élue d'avoir qualifié l'association des musulmans de Bagnolet d'« islamo-nazis » et d'avoir décrit cette association comme « une école coranique illégale », la Cour a jugé que le fait imputé à cette élue d'avoir tenu des propos islamophobes caractérisait des faits précis pouvant revêtir une qualification pénale et portait ainsi atteinte à son honneur ou à sa considération (Crim. 16 oct. 2018, n° 17-87.418, Youcef X.).
C – Imputation de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération
Les imputations portant sur la possible commission d'infractions ou sur des faits contraires à l'éthique, concernant par exemple le maniement des fonds publics par un élu, présentent un caractère diffamatoire en ce qu'elles portent atteinte à son honneur ou à sa considération. C'est le cas d'allégations, même tenues par un opposant politique de longue date dans le cadre d'une campagne électorale autorisant une plus grande liberté d'expression, imputant au maire d'une commune ainsi qu'au directeur d'un centre communal d'action social, des soupçons d'utilisation abusive des fonds de cet organisme (Crim. 19 juin 2018, no 16-82.602, Maurice X. et A.).
Au contraire, ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération des propos imputant, sur un ton ironique, à un maire d'avoir commis des délits imaginaires tels que les « délits d'ingérence de la part d'une personne non concernée par des affaires d'autrui, et de prise de position et abus de pouvoir illégal dans une commune étrangère à la sienne » (Crim. 9 janv. 2018, no 17-80.492, M. Raymond X.).
L'acte initial de poursuite, ne fixe irrévocablement les termes de la poursuite qu'en ce qu'il précise les propos incriminés, les qualifie et indique le texte de la loi sur la liberté de la presse applicable. S'agissant du caractère diffamatoire des propos, les juges doivent rechercher s'ils ne renferment pas d'autres imputations ou allégations diffamatoires que celles contenues dans la citation. Doit ainsi être cassé l'arrêt d'une cour d'appel s'étant contenté de rechercher, conformément aux termes de la citation, si les propos poursuivis par une dirigeante de partie lui imputaient d'être personnellement bénéficiaire d'un détournement d'argent public, sans rechercher si les propos poursuivis ne renfermaient pas d'autres imputations ou allégations diffamatoires et notamment le fait d'avoir tiré profit, en sa qualité de présidente du Parti, de ces agissements (Crim. 11 déc. 2018, no 17-84.899, Marine Le Pen).
Cela ne doit cependant pas mener à une surinterprétation des imputations. En l'espèce un reportage sur le marché de Noël des Champs-Élysées relatait la panne du terminal de carte bancaire sur certains stands avant d'imputer au gérant du marché de privilégier les espèces pour les paiements rendant incertaines les estimations du chiffre d'affaires. Les propos n'affirmaient pour autant pas que la panne des terminaux de carte était une manœuvre délibérée de la part du gérant, dans l'intention de frauder sur le montant total du chiffre d'affaires du marché. Selon la Cour d’appel de Paris, ayant infirmé le jugement du tribunal, ces propos exprimés en termes très généraux et prudents n'imputaient au requérant la commission d'une fraude et partant de fait précis portant atteinte à son honneur ou à sa considération (Paris, pôle 2, ch. 7, 6 sept. 2018, no 17/01503, M. Campion c/ B. de la Villardière et A.).
Ces décisions sont révélatrices du pouvoir d'interprétation des juges du fond sur le sens et l'analyse des propos poursuivis pouvant conduire à des décisions contraires rendues par différents degrés de juridictions.
D – Des propos visant une personne, un corps identifié ou identifiable
La Cour de cassation a procédé à un rappel des règles applicables dans des arrêts traitant de l'identification de la personne ou du corps visé par l'imputation diffamatoire. Si la personne n'est pas nommément identifiée dans l'écrit, il suffit que son identification « ait été rendue possible par les termes de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques » (Crim. 27 mars 2018, no 17-80.716, Fabien X.). S'agissant d'une allégation mettant en cause le fonctionnement d'un comité d'entreprise, affichée sur le panneau réservé à un syndicat au sein d'un établissement d'une enseigne de bricolage, le syndicat – non visé – n'a pas qualité pour agir. En revanche, la fonction de trésorier du comité d'entreprise peut constituer une circonstance extrinsèque rendant possible son identification, lui conférant ainsi une qualité pour agir en diffamation contre l'auteur de l'affichage (Civ. 1re, 11 juill. 2018, no 17-21.757, Le syndicat CFDT services Morbihan et A.).
La diffamation publique peut en outre faire l'objet de diverses incriminations qui varient en fonction de la qualité ou des fonctions de la personne visée.
1 – Personnes publiques
La diffamation visant les « personnes publiques » relève de l'article 31, alinéa 1er, qui punit la diffamation des personnes qu'il énumère. Les magistrats, qui ne sont pas nommément visés par le texte, bénéficient néanmoins de sa protection en tant que fonctionnaires publics, à la condition qu'ils soient, « investis, dans une mesure quelconque, d'une portion de l'autorité publique française ». À ce sujet, on peut relever cette décision de la Cour d’appel de Paris concernant un magistrat détaché à Monaco depuis plusieurs années pour y exercer les fonctions de procureur général. Selon les allégations publiées dans deux articles, ledit magistrat allait faire l'objet d'une « exfiltration » à caractère disciplinaire suite à des « affaires embarrassantes » s'étant déroulées dans la principauté. La Cour d’appel de Paris a considéré que l'article 31, alinéa 1er, était applicable nonobstant le fait que le magistrat en question soit détaché et ne soit donc plus ou pas encore dépositaire de l'autorité publique en France. En effet, c'est sa mutation ou « exfiltration » selon les termes des articles qui constitue le cœur du sujet et le visent en qualité de magistrat français prochainement installé à la Cour de cassation. Concernant les « affaires embarrassantes », si elles sont en principe liées à ses fonctions dans la principauté et détachables de son statut de magistrat français, elles sont en réalité indivisibles de l'allégation précédente en raison du lien de causalité manifeste entre les deux : la mutation étant présentée dans les articles comme la conséquence des affaires monégasques (Paris, pôle 2, ch. 7, 20 sept. 2018, no 17/08274, Jean-Pierre D. c/ A. Gernelle).
Mais encore faut-il que la diffamation soit commise, d'après l'article 31, alinéa 1er « à raison de leurs fonctions ou de leur qualité ». Les propos poursuivis doivent s'apprécier, selon une jurisprudence établie, non d'après le mobile ou le but recherché par leur auteur, mais d'après la nature du fait sur lequel ils portent. Ils doivent contenir la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire. Dans une première affaire, l'intéressé, fonctionnaire et délégué syndical, était mis en cause dans un tract pour avoir obtenu illégalement une nouvelle bonification indiciaire à laquelle il n'avait pas droit, de sorte que sa qualité de fonctionnaire constituait le support nécessaire de l'acte critiqué (Crim. 27 mars 2018, no 17-80.716, Fabien X., préc.).
En revanche, il est clair que la simple mention des fonctions de la personne visée ne suffit pas à emporter l'application de l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881. Dès lors, la Cour de cassation approuve la solution retenue par une cour d'appel admettant la validité d'une citation délivrée sur le fondement de l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 suite à la publication d'articles imputant à une élue la tenue de propos islamophobes dans les commentaires d'un article publié en ligne. Les propos ne relèvent pas de l'article 31, alinéa 1er, de la loi, car les faits ainsi imputés n'ont pas été publiés dans le cadre de ses fonctions d'élue ni par un mode de communication mis à sa disposition par la ville, ni dans le cadre des débats devant le conseil municipal (Crim. 16 oct. 2018, no 17-87.418, Youcef X., préc.).
De la même façon, s'agissant de parlementaires auxquels il était imputé d'avoir sifflé une femme voilée et mère d'une victime d'un acte terroriste, le tribunal a considéré qu'un tel comportement est sans rapport avec les activités et les fonctions de parlementaire, qui n'étaient ni le moyen ni le support nécessaire de l'imputation diffamatoire. Peu importe la qualité de parlementaire des personnes visées ou que le comportement imputé se soit déroulé lors d'un colloque à l'Assemblée nationale. Les faits auraient donc dû être poursuivis sur le fondement du délit de diffamation publique envers un particulier et le tribunal ne peut que relaxer, en l'absence de tout pouvoir de requalification (TGI Paris, 17e ch. corr., 15 juin 2018, C. Goasguen et A. c/ R. Brauman).
2 – Forces armées
Une plainte en diffamation visant l'article 31, alinéa 1er, avait été déposée par une association de défense de la mémoire des harkis à la suite de propos tenus par le présentateur d'une émission culturelle leur imputant d'avoir pratiqué la torture pendant la guerre d'Algérie. La Cour de cassation, confirmant un arrêt de la Cour d’appel de Paris, a jugé l'infraction de diffamation non constituée. La plaignante aurait dû, en effet, poursuivre au visa de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, les harkis constituant depuis la loi du 7 mars 2012 une force supplétive de l'armée française (Crim. 19 juin 2018, no 17-85.116, L'association Générations Mémoires Harkis).
3 – Dirigeant d'une société
Une société porte plainte et se constitue partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier en raison d'un article en ligne imputant à son dirigeant, portant le même nom, d'avoir joué un rôle important dans le financement illicite de la campagne électorale d'un ancien Président et d'avoir profité de son rôle d'intermédiaire dans cette affaire pour obtenir une convention de gestion portuaire. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et rappelé qu'une diffamation visant une personne physique ne peut rejaillir sur une personne morale qu'à la condition que les imputations diffamatoires lui soient étendues, fut-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation. En l'espèce, le fait que la personne morale ait pu tirer profit de l'obtention de la convention de gestion portuaire n'était pas suffisant pour considérer qu'elle était elle-même mise en cause dans les propos, et la cour d'appel avait donc justement déduit que la société n'était visée par aucune imputation diffamatoire (Crim. 11 déc. 2018, no 17-85.157, Sté Bolloré). La Cour de cassation avait pourtant jugé, par le passé, que « Des propos présentant une personne morale comme bénéficiaire d'agissements frauduleux commis par son président et certains de ses dirigeants, portent nécessairement atteinte à la considération de ladite personne morale » (Crim. 19 déc. 2000, no 00-81.860 ; Civ. 1re, 28 janv. 2010, no 08-21.869)
III – Faits justificatifs
A – Exception de vérité
Selon une jurisprudence constante, la preuve de la vérité des faits doit être parfaite et corrélative à l'imputation formulée dans sa matérialité et dans sa portée. Les juges doivent procéder à une analyse complète et précise de l'intégralité des pièces produites. Les décisions admettant ce moyen de preuve sont si rares qu'il faut les saluer. Il faudrait surtout encourager les juridictions, sans pour autant remettre en cause les acquis jurisprudentiels, à ne pas priver d'effet ce moyen de défense.
On rappellera que la Cour estime notamment lorsqu'une imputation concerne une infraction pénale, que doit être rapportée la preuve d'une condamnation pénale définitive. La Cour a pourtant jugé, de façon particulièrement étrange que la preuve de la vérité de l'imputation d'Arnaud Montebourg selon laquelle Jean-Marie Le Pen a fait l'éloge de la Gestapo et de l'occupation allemande, ne peut être rapportée par le simple constat qu'il a été définitivement condamné pour contestation de crimes contre l'humanité, suite à des propos minimisant les exactions commises par l'occupation allemande et la Gestapo. L'exception de vérité avait pourtant été admise aussi bien en appel qu'en première instance (Crim. 27 févr. 2018, no 17-81.381, J.-M. Le Pen c/ A. Montebourg).
Finalement dans une décision très remarquée, la Cour d’appel de Paris a confirmé que l'exception de vérité, reposant notamment sur les témoignages d'historiens, devait être admise pour des propos d'Ariane Chemin imputant à M. Faurisson d'être un « faussaire de l'histoire », c'est-à-dire de la dénaturer par des procédés mensongers. Les historiens interrogés et cités en tant que témoin, au titre de l'offre de preuve, ont fait ressortir que ses propos et sa démarche intellectuelle étaient étrangers à la démarche habituelle des historiens (Paris, pôle 2, ch. 7, 12 avr. 2018, no 17/04449, R. Faurisson c/ A. Chemin et A.).
B – Bonne foi
L'excuse de bonne foi est une création jurisprudentielle aujourd'hui bien établie, qui nécessite de prouver que sont réunies quatre conditions cumulatives tenant (i) au but légitime d'information (ii) à la réalisation d'une enquête sérieuse, (iii) à l'absence d'animosité personnelle et (iv) la prudence dans l'expression. Sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme, la notion de la bonne foi a évolué en consacrant la notion de sujet d'intérêt général, dorénavant au cœur des mécanismes européens et internes de protection de la liberté de la presse. En outre, les limites de la critique admissible sont plus larges dans certains domaines identifiés par la jurisprudence, tels que la polémique politique ou syndicale. De nombreuses décisions rendues cette année le démontrent.
1 – But légitime de l'information / sujet d'intérêt général
La Cour européenne des droits de l'homme rappelle constamment, sur le fondement de l'article 10, § 1, de la Convention, que la liberté d'expression comprend la liberté, pour chacun, de recevoir des informations. C'est en ce sens que doit être comprise la condition tenant au but légitime de l'information énoncée. En sont évidemment exclues les informations qui ne sont portées à la connaissance du public que dans un but malveillant mais de telles décisions sont rares.
Évoquer la responsabilité d'une société dans l'accaparement des terres au Cameroun s'inscrit dans un débat d'intérêt général relatif à la responsabilité des multinationales dans l'utilisation des terres agricoles. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation qui a en outre considéré que les propos tenus par un site d'information reposaient sur une base factuelle suffisante, le site s'appuyant sur divers rapports d'organisations internationales et sur des éléments de nature à étayer ses affirmations, nonobstant quelques approximations ou omissions dans le détail des faits. Dans cet arrêt la qualité du site, média d'opinion, est prise en compte pour apprécier plus souplement la bonne foi (Crim. 7 mai 2018, no 17-82.663, Sté Bolloré).
La Cour de cassation a accordé à deux reprises le bénéfice de la bonne foi à des journalistes qui avaient révélé des atteintes au secret des sources, thème de la plus criante actualité. La Cour a, en effet, considéré que les publications mettant en cause des fonctionnaires et des magistrats, même nommément, ayant fait procéder à des écoutes ou espionner des journalistes, constituaient des sujets d'intérêt général. Il en va ainsi du journal ayant publié sur son site internet un article imputant à un magistrat des mises sur écoute de journalistes. Le passage incriminé portait sur un sujet d'intérêt général, à savoir celui de l'atteinte au secret des sources des journalistes, et s'inscrivait dans un article qui rappelait une affaire précédente du même type qui avait eu un retentissement national et impliquait le même magistrat. Par ailleurs, malgré l'emploi du terme, juridiquement erroné, d'« écoutes », le passage reposait sur une base factuelle suffisante constituée par des décisions judiciaires, le contenu d'une plainte et des articles de presse (Crim. 7 mai 2018, no 17-82.411, Philippe X.).
Dans le second cas, un journal a publié un article affirmant qu'un ancien président de la République demandait au chef de la DCRI de l'époque d'espionner les journalistes qui se livraient à des enquêtes gênantes pour sa présidence et qu'une cellule avait été créée au sein de la direction spécialement à cet effet. La Cour de cassation a jugé que le propos incriminé s'inscrivait dans un débat d'intérêt public ayant un retentissement national relatif à la collecte illégale de données personnelles de certains journalistes par l'État (Crim. 10 avr. 2018, no 17-81.054, Michel X. et A.).
Si vie privée et information du public ne font pas toujours bon ménage, le fait de rapporter dans un article l'hospitalisation d'urgence dans un service psychiatrique d'un maire, faits relevant évidemment de la vie privée de celui-ci, relève également d'un débat d'intérêt général pour les personnes dont il est le représentant (Crim. 30 oct. 2018, no 18-81.663, M. Christophe X. et A.).
Le fait d'imputer au maire d'une commune ainsi qu'à son adjoint des faits de fraude et de détournements d'argent public relève d'un débat d'intérêt général portant sur les modalités de financement d'une campagne électorale et la rémunération des membres d'un parti (Crim. 8 août 2018, no 17-82.893, Bruno Y. et Steeve Z.)
Enfin, des élus rapportaient dans le magazine d'information d'une ville le fait que les élus d'une liste concurrente avaient demandé au cours d'un conseil municipal si l'orientation sexuelle des animateurs périscolaires embauchés par la ville était contrôlée, démontrant ainsi leur « homophobie et obscurantisme ». Dès lors que les propos tenus par les requérants n'ont pas été dénaturés, le fait de les rapporter s'inscrivait dans un débat d'intérêt général sur le recrutement des animateurs périscolaires dans le cadre du conseil municipal de la ville et reposaient sur une base factuelle suffisante au regard du contexte politique et médiatique relatif à la théorie du genre (Crim. 30 oct. 2018, no 17-87.210, Fabien X.)
2 – Travail sérieux d'enquête / base factuelle suffisante
Des quatre conditions cumulatives qui composent l'excuse de bonne foi, la condition tenant à l'enquête sérieuse est sans conteste celle qui fait le plus souvent défaut, et partant entraîne le plus grand nombre de condamnations. Le journaliste, pour pouvoir bénéficier de l'excuse de bonne foi, doit justifier d'une enquête sérieuse préalablement à la rédaction de l'article.
Un article imputait à Marine Le Pen d'avoir employé de façon fictive la baby-sitter de ses enfants en tant qu'assistante parlementaire ainsi que des faits d'escroquerie au préjudice de son parti politique. La Cour de cassation a jugé que les propos diffamatoires reposaient sur une base factuelle suffisante puisqu'ils s'appuyaient sur des articles de presse et des déclarations précédemment publiés dans un ouvrage consacré à la partie civile (Crim. 27 nov. 2018, no 18-83.817, Marine Le Pen et A.).
Dans l'affaire du faux tract de Jean-Luc Mélenchon distribué par des militants du Front national, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel ayant admis la bonne foi au bénéfice de l'avocate de Jean-Luc Mélenchon ayant accusé Marine le Pen d'être une « délinquante ». Pour la Cour, elle s'était exprimée en tant que conseil de l'homme politique dans le cadre d'une joute électorale. La Cour de cassation ajoute que la base factuelle est suffisante dès lors que la présidente du parti avait déclaré deux jours avant « si j'avais voulu faire ça en secret, je n'aurais pas envoyé mes cent militants en plein jour » (Crim. 7 mai 2018, no 17-82.640, M. Le Pen).
La Cour de cassation, cassant l'arrêt d'une cour d'appel, a jugé que les propos tenus par un élu visant son prédécesseur au sujet de l'endettement de la commune s'inscrivaient dans une polémique politique et reposaient sur une base factuelle suffisante, peu importe le caractère collégial des décisions à l'origine de l'endettement, dont la responsabilité ne pouvait reposer sur une seule personne (Crim. 23 janv. 2018, no 17-81.874, Jean-Pierre M.).
La Cour d’appel de Paris, infirmant un jugement de la 17e chambre, a jugé qu'une journaliste de Mediapart justifiait d'une base factuelle suffisante pour légitimement écrire que le trésorier du micro-parti de Marine Le Pen faisait un salut fasciste, ce dernier soutenant quant à lui qu'il s'agissait d'un geste amical à ses amis. La journaliste versait aux débats de nombreux éléments, récents et passés, démontrant les sympathies de cette personne pour le régime nazi (Paris, pôle 2, ch. 7, 13 juin 2018, no 17/07088, A. Loustau c/ E. Plenel et A.).
3 – Absence d'animosité personnelle
L'animosité personnelle est spécifique en droit de la presse. Elle ne se confond pas avec la notion d'intention de nuire, mais s'apprécie autour de l'existence d'éléments extérieurs et antérieurs aux imputations poursuivies, ou d'un « motif dissimulé » (Paris, pôle 2, ch. 7, 9 mars 2017).
Dans la décision du 11 avril 2018 évoquée précédemment dans cette synthèse, une représentante syndicale avait distribué un tract devant un établissement hospitalier, comprenant une caricature du directeur de l'association et des « bulles » de texte suggérant de façon virulente qu'il était un dictateur, refusant le dialogue social, détournant des fonds et se rendant coupable d'infractions pénales. La Cour de cassation a approuvé l'analyse de la cour d'appel selon laquelle les propos diffamatoires, tout en portant sur un sujet d'intérêt général dans un contexte de polémique syndicale, ne pouvaient bénéficier de l'excuse de bonne foi en ce qu'ils nourrissaient en réalité une animosité de nature personnelle à l'égard de la partie civile (répétition du nom du directeur, nombreuses attaques personnelles, Crim. 10 avr. 2018, no 17-80.315, Véronique X., préc.)
La Cour de cassation a confirmé le rejet de la bonne foi s'agissant d'un homme politique ayant accusé au cours d'une conférence de presse un président de région de pratiquer « le clientélisme », « le favoritisme », d'« acheter avec l'argent public le silence de la presse », et de « dilapider l'argent public pour aller en Amérique, Australie ou aux Seychelles », jugeant notamment que le prévenu était mu par une animosité personnelle dans ses propos (Crim. 23 janv. 2018, no 16-85.316, Thierry R.).
4 – Prudence dans l'expression
La condition de la prudence dans l'expression, si elle fait toujours partie des conditions au titre de la bonne foi, a une portée plus relative dans la mesure où cette condition a été nuancée sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme qui juge depuis de nombreuses que « la liberté journalistique comprend le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation » (CEDH 7 déc. 1976, Handyside c/ Royaume-Uni).
Le secrétaire d'une association qui contestait un projet de fusion de deux communes et diffusait publiquement un courriel imputant à une directrice générale des services d'une des communes d'avoir falsifié et diffusé des courriers n'a pas bénéficié de l'excuse de bonne foi dès lors qu'elle a sans prudence ni mesure, imputée à la partie civile une infraction pénale sans s'assurer de la suite donnée à la plainte déposée contre elle (Crim. 10 avr. 2018, no 17-81.467, Philippe X.)
La Cour de cassation a, en revanche, reconnu la prudence du journaliste s'étant contenté de rapporter des propos de témoins, retranscrits entre guillemets qui imputaient à une société de pompes funèbres des négligences dans le traitement des défunts et la restitution de leurs cendres aux familles. Dès lors qu'aucune contradiction n'existait entre les propos rapportés et ceux des témoins entendus dans le cadre de la procédure, il ne pouvait être fait grief aux prévenus d'avoir manqué à la règle de prudence (Crim. 19 juin 2018, no 17-82.526, Vincent X. et Yohan Y.).
Les juridictions sanctionnent en revanche de manière systématique la dénaturation de propos, même dans un contexte électoral permettant, pourtant, une plus grande liberté de ton. La Cour de cassation a confirmé la condamnation de journalistes pour deux articles qui imputaient à une élue la tenue de propos islamophobes visant une association, propos qu'elle n'avait en réalité pas tenus (Crim. 16 oct. 2018, no 17-87.418, Youcef X., préc.)
IV – Injure
Les termes « sinistre personnage » et « malade schizophrène » prononcés sur un réseau social sont jugés constitutifs d'injures et dépourvus de toute distanciation ironique susceptible d'en modérer la portée et d'en exclure la dimension injurieuse. L'auteur du commentaire ne saurait bénéficier de l'excuse de provocation résidant normalement dans une riposte immédiate, spontanée et proportionnée à l'attaque. En l'espèce, le tribunal a jugé qu'il existait une disproportion entre le caractère gratuit et l'agressivité du propos et le message auquel il répond, à savoir la photo d'un postérieur dont il n'est même pas avéré qu'il soit destiné à la prévenue (TGI Paris, 17e ch. civ., 23 mai 2018, M. X.)
A – Injure à raison de l'origine, de la race ou de la religion
N'est pas constitutif d'une injure visant un groupe de personnes à raison de l'origine, de la race ou de la religion le fait de déclarer que « la musique nègre s'adresse au cerveau reptilien ». Les propos relèvent, en effet, d'une opinion concernant un genre musical, d'après la Cour d’appel de Paris infirmant une décision rendue le 25 janvier 2017 par la 17e chambre correctionnelle (Paris, pôle 2, ch. 7, 6 juin 2018, no 17/01066, Avocats sans frontières et A. c/ H. de Lesquen).
B – Injure à raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre
Un homme politique regrettait sur son blog que la cérémonie d'hommage à un policier ait mené à faire mention de son homosexualité. Selon lui, cette particularité aurait dû être « tenue à l'écart ». Le tribunal a jugé le délit d'injure à caractère homophobe caractérisé par la suggestion de la mise « à l'écart » de cet aspect et donc du partenaire du policier, expression outrageante rejaillissant sur l'ensemble des personnes homosexuelles (TGI Paris, 17e ch., 28 nov. 2018, Etienne C. c/ J.-M. Le Pen).
Relève également de ce type d'injure le fait de qualifier les personnes transgenres de « vicieux ». En effet, le terme est manifestement outrageant en ce qu'il renvoie à la dépravation, à l'immoralité et à la perversion. En revanche, n'est pas injurieux le fait de les qualifier de « malheureux qui veulent changer de sexe sont des malades qui relèvent de la psychiatrie ». La référence au malheur ou à la maladie mentale ne pouvant être considérée comme outrageante. Il nous semble toutefois que cette décision est critiquable, la Cour de cassation ayant jugé que le fait de traiter un maire de « bipolaire », donc atteint d'une maladie mentale, correspondait à la définition de l'injure (Paris, 12 déc. 2018, no 18/03112, Ministère public c/ H. de Lesquen ; comp. avec Crim. 28 mars 2017, no 15-87.812).
C – Droit à l'humour
Les messages nécessairement courts postés sur Twitter génèrent souvent des publications à l'humour particulièrement incisif. Une particularité du réseau social qui n'a pas échappé à nos juridictions. Dans deux affaires notables, le droit à l'humour a ainsi permis d'excuser des traits d'esprit cinglants voire « potaches ». Il en va ainsi du tweet de Maître Eolas visant l'Institut pour la justice. L'invective, quoique grossière, répondait de façon spontanée à l'interpellation d'un internaute sur un réseau social « imposant des réponses lapidaires » et ne tendait pas à atteindre les personnes dans leur dignité ou leur réputation. Ils exprimaient en réalité une opinion « sur un mode satirique et potache, dans le cadre d'une polémique ouverte, sur les idées prônées par une association défendant une conception de la justice opposée à celle que le prévenu, en tant que praticien et débatteur public, entendait lui-même promouvoir » (Crim. 8 janv. 2019, no 17-81.417, M. Eolas (pseudonyme) et L'association Institut pour la justice).
Il en va de même s'agissant de tweets visant la maire de Paris, la qualifiant de « vieille morue » en lien avec l'organisation polémique d'un événement par la mairie, quelques temps auparavant. Ces propos sont également couverts par la liberté d'expression s'agissant d'une polémique politique et humoristique (TGI Paris, 17e ch., 15 févr. 2018, A. Hidalgo c/ Pierre G.)
De la même façon, un photomontage humoristique assimilant un élu à un dictateur, réalisé par ses opposants politique, même hors de tout contexte d'élection, est couvert par la liberté d'expression, s'agissant d'un montage clairement parodique, caricatural et humoristique, ne portant pas atteinte à la dignité de l'élu et s'inscrivant dans le cadre d'une polémique politique et d'un débat d'intérêt général sur le respect par le maire de la liberté d'expression de ses opposants (Paris, pôle 2, ch. 7, 11 oct. 2018, no 18/00470, J.-P. Gorges c/ A. Chaubeau).
En revanche, ne sauraient relever de l'humour les grossièretés proférées en nombre par des internautes commentant l'interview d'une directrice d'une association d'aide aux réfugiés, la ramenant de façon dégradante à un objet sexuel et un « jeu de mot » lui imputant un comportement sexuel. Le tribunal a déclaré les auteurs des messages coupables d'injures sexistes (TGI Paris, 17e ch., 6 nov. 2018, Alice B. c/ Stéphane C. et A.).
V – Provocation
Au cours des dernières années, les fréquents revirements de jurisprudence concernant les infractions de provocation, ont pu, selon certains auteurs, porter atteinte à la sécurité et à la prévisibilité juridique de ces infractions. Les décisions récentes de la Cour de cassation tendent à consacrer une interprétation restrictive de la provocation, laquelle n'est caractérisée que si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés tendent à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées.
A – Provocation à la haine raciale
Ainsi les paroles de la chanson de rap « Nique la France » ne contiennent aucun appel ni exhortation à la discrimination ou à la haine (Crim. 11 déc. 2018, no 18-80.525, Saïd X.). En l'absence de provocation, c'est-à-dire d'incitation du public à la discrimination, à la haine ou à la violence, les propos racistes peuvent néanmoins être poursuivis du chef de diffamation raciale telle que visée à l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881. C'est également le cas d'un dessin diffusé sur internet, contenant un personnage supposé représenter la communauté juive, à laquelle il impute d'exploiter à des fins financières la mémoire de la Shoah (Paris, pôle 2, ch. 7, 13 déc. 2018, no 18/02717, Licra c/ A. Soral et A.).
La Cour de cassation casse la décision d'une cour d'appel ayant retenu la culpabilité d'un prévenu, candidat aux élections départementales de 2015, qui avait mis en ligne un dessin représentant l'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira sous les traits d'un singe, alors que le dessin, s'il était susceptible de caractériser une injure raciale, ne contenait, ni en lui-même ni analysé au regard des éléments extrinsèques, d'appel ou d'exhortation, même sous une forme implicite, à la discrimination, la haine ou la violence (Crim. 9 janv. 2018, no 17-80.491, M. André Z.).
B – Provocation à la haine à caractère homophobe
La Cour de cassation casse sans renvoi la décision de cour d'appel qui avait condamné Christine Boutin pour provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personne à raison de leur orientation sexuelle, suite à son affirmation au cours d'une interview que « l'homosexualité est une abomination » (Crim. 9 janv. 2018, no 16-87.540, C. Boutin).Comme en matière de provocation à la haine raciale ou religieuse, la Cour de cassation laisse entendre, non pas que les propos sont admissibles au regard de la liberté d'expression mais bien plutôt la nécessité de les poursuivre sous une autre qualification, à savoir la diffamation ou l'injure, le propos étant bien qualifié d'« outrageant », mais ne comportant pas de provocation d'autrui à la haine.
C – Négationnisme
La Cour de cassation maintient son interprétation s'agissant de la contestation des crimes contre l'humanité (art. 24 bis de la loi du 29 juill. 1881) et considère qu'est justifiée la décision la cour d'appel ayant déclaré Jean-Marie Le Pen coupable du délit de contestation de crimes contre l'humanité pour avoir qualifié de « détail de l'histoire de la guerre » l'emploi des chambres à gaz pendant la Seconde Guerre mondiale, minoration outrancière desdits crimes revenant à en contester l'existence (Crim. 27 mars 2018, no 17-82.637, J.-M. Le Pen).
La cour d'appel a également considéré le délit de contestation de crimes contre l'humanité constitué par la minoration outrancière des crimes commis, qui procède du fait pour le prévenu d'avoir remis en cause et minimisé par insinuations, non pas l'existence des chambres à gaz mais les témoignages de survivants de la Shoah dans une série de tweets (Paris, 6 juin 2018, no 17/01082, H. de Lesquen).
VI – Apologie
A – Apologie de crimes de guerre et apologie de crimes contre l'humanité
La Cour de cassation a examiné en mai 2018 une affaire dans lequel le procureur de la République de Paris avait ordonné des poursuites à l'encontre d'une figure publique ayant regretté dans une publication sur un réseau social que « le boulot », désignant ainsi la politique d'extermination nazie, n'ait pas été « fini » s'agissant des époux Klarsfeld. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel en ce qu'il a jugé caractérisé le délit d'apologie de crime contre l'humanité, le prévenu ayant présenté la Shoah sous un jour favorable, voire même désirable. En revanche, l'arrêt est cassé en ce qu'il a également jugé constitué l'apologie de crime de guerre, sans expliciter en quoi les éléments retenus au titre de ce second délit. La Cour de cassation rappelle ainsi que l'apologie de crimes de guerre et l'apologie de crimes contre l'humanité, s'ils sont proches, sont deux délits distincts et que la condamnation pour l'un de ces délits n'entraîne pas automatiquement la condamnation pour l'autre. Les juridictions doivent donc nécessairement préciser, dans leurs décisions, les éléments constitutifs retenus pour chacun des deux délits (Crim. 7 mai 2018, no 17-82.656, Alain Soral).
B – Apologie du terrorisme
Au cours d'une interview radio, mise en ligne sur le site d'un journal, un militant politique déclarait avoir trouvé « très courageux » les auteurs d'actes de terrorisme. Il a été déclaré coupable d'apologie d'un acte de terrorisme au moyen d'un service de communication en ligne, jugement confirmé en appel. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel, jugeant qu'il était justifié tant au regard de l'article 421-2-5 du code pénal réprimant l'apologie du terrorisme, que de l'article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme. Les propos étaient accessibles par un service de communication en ligne, ce dont le prévenu avait connaissance. Ils tendaient à inciter autrui à porter un jugement favorable sur une infraction qualifiée de terroriste, même s'ils ont été prononcés dans le cadre d'un débat d'intérêt général, au cours d'un discours de nature politique. On peut noter l'analyse formulée par la cour d'appel et approuvée par la Cour de cassation, qui précise que l'apologie « résulte de la glorification de l'acte mais aussi de la défense du terroriste, le courage, antonyme de la terreur que font régner les terroristes étant regardé comme une des principales vertus de l'homme, indispensable à celui considéré comme un héros ». La restriction à la liberté d'expression est en l'espèce une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale et à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (Crim. 27 nov. 2018, no 17-83.602, Jean-Marc X.).
VII – Vie privée, droit à l'image, publication interdite
Comme la Cour de cassation a eu l'occasion de le rappeler, le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l'image d'une personne d'une part et le droit à la liberté d'expression d'autre part, ont la même valeur normative.
Saisi à raison d'une publication dont il est allégué qu'elle porte atteinte à l'image ou à la vie privée de la personne, le juge doit alors procéder à la mise en balance de ces intérêts par une analyse concrète au cas par cas, des différents critères dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme dans sa jurisprudence antérieure, à savoir, en premier lieu, la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général puis, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (Civ. 1re, 21 mars 2018, no 16-28.741).
Aussi, comme en matière de diffamation ou d'injure, le caractère d'intérêt général de la publication emportera souvent, sinon automatiquement le caractère justifié de celle-ci au visa de l'article 10 de la Convention, tendant ainsi à une certaine homogénéité de ce fait justificatif à travers les différentes infractions de presse, à l'image de la jurisprudence de la Cour européenne dont la Cour de cassation fait directement application afin de protéger le débat public. En effet, faisant application de ces principes, la Cour de cassation a cassé au visa des articles 8 et 10 de la Convention et 9 du code civil, l'arrêt d'appel ayant considéré que la révélation, dans un livre dédié à un parti politique historiquement réputé homophobe, de l'orientation sexuelle de l'un de ses membres dirigeants, n'était pas justifiée par le droit à l'information du public, ni proportionnée à l'atteinte portée à la vie privée. La Haute juridiction considère au contraire que les interrogations de l'auteur de l'ouvrage sur l'évolution de la doctrine d'un parti politique, présenté comme plutôt homophobe à l'origine, et l'influence que pourrait exercer, à ce titre, l'orientation sexuelle de plusieurs de ses membres dirigeants, relevaient d'un débat d'intérêt général (Civ. 1re, 11 juill. 2018, no 17-22.381, M. X. c/ S. B).
E.-T., G.- R. et T. B.L.




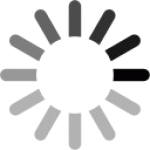
 S'abonner à Legipresse
S'abonner à Legipresse Feuilleter le dernier numéro
Feuilleter le dernier numéro