(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Recherche
(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Sur le même sujet
Responsabilité contractuelle de droit commun, titularité des droits d'exploitation sur le format d’une émission et son titre ,et compétence judiciaire
Enews Legipresse
Le club Légipresse
Vidéos
Actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique : précisions sur le domaine de la compétence exclusive du TGI
Aux termes de l'article L. 331-1, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. Ainsi, les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun relèvent de la compétence de ces tribunaux, lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique.
L’arrêt rapporté répond à la question, importante en pratique, du domaine exact de la compétence exclusive édictée par le législateur en faveur du tribunal de grande instance en matière de propriété littéraire et artistique.
On sait que l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle (« CPI ») réserve à la seule compétence de certains tribunaux de grande instance, désignés par voie réglementaire(1), « les actions civiles(2) et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique »(3).
La détermination du domaine de cette compétence exclusive impose donc de définir le sens de la formule « relatives à la propriété littéraire et artistique ».
S’il ne fait pas de doute que cette formule vise les hypothèses où le demandeur fonde expressément son action sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au droit d’auteur, aux droits voisins ou au droit du producteur de bases de données(4), qu’en est-il si ses demandes sont relatives à l’exécution (ou la résolution) d’un contrat et sont fondées uniquement sur le droit commun des contrats (code civil), alors même que ce contrat est notamment relatif à un droit de propriété littéraire et artistique(5) ?
Par exemple, tel exploitant d’une œuvre de l’esprit réclame le paiement de redevances à un licencié, ou conteste la bonne exécution du contrat par un coéditeur ou un coproducteur et en réclame la résolution.
Faut-il alors, pour déterminer le tribunal compétent en application de l’article L.331-1 CPI, s’attacher exclusivement au fondement juridique explicite de la demande ? Dans l’affirmative, si le défendeur est commerçant, le litige relèvera, dans notre hypothèse, de la compétence du tribunal de commerce. Ou bien, le fait que le contrat litigieux implique un droit de propriété littéraire et artistique peut-il avoir une incidence sur la compétence et, dans l’affirmative, à quelles conditions ? C’est à cette question que répond l’arrêt rapporté dans les circonstances suivantes.
Une société ARDIS avait concédé à une société TSE le droit de produire l’émission de télévision « Tout le monde en parle » ; le contrat stipulait apparemment un partage par moitié, entre les parties, des recettes d’exploitation à l’étranger du format de cette émission. Estimant que la société ARDIS n’avait pas exécuté son obligation de lui verser sa part desdites recettes d’exploitation, la société TSE l’assigna devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir communication de documents comptables et le paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues. La société ARDIS souleva une exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance, sur le fondement de l’article L.331-1 CPI, qui fut accueillie par le tribunal de commerce.
Par arrêt en date du 31 octobre 2017, la Cour d’appel rejeta le contredit formé par la société TSE à l’encontre du jugement d’incompétence, au motif essentiel que le litige relatif au partage des recettes trouvait sa source dans la « réalité » des droits de propriété intellectuelle respectifs des parties, lesquelles étaient en désaccord sur ce point : la société TSE s’affirmait copropriétaire du format de l’émission, ce qui fondait, selon elle, sa créance de redevances, tandis que la société ARDIS contestait cette position et faisait valoir au contraire qu’elle était seule titulaire des droits afférents audit format, sans que, selon la Cour d’appel, le contrat permette, seul, de trancher cette question.
En conséquence, la juridiction devait, pour statuer sur les demandes relatives au paiement des redevances, préalablement caractériser la titularité des droits sur le format de l’émission et son titre. Pour cette raison, jugea la cour d’appel, le litige relevait de la propriété littéraire et artistique et donc de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, conformément à l’article L.331-1 CPI.
Le pourvoi formé par la société TSE à l’encontre de l’arrêt d’appel faisait valoir que les demandes de cette société tendaient uniquement à engager la responsabilité contractuelle de la société ARDIS à raison de l’inexécution de son obligation de lui payer 50 % des recettes d’exploitation à l’étranger du format, et n’impliquaient donc pas l’application des règles de la propriété littéraire et artistique.
Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation rejette ce pourvoi, au motif que « la détermination des obligations de chacune des parties et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles du droit de la propriété littéraire et artistique ». Et la Cour de préciser qu’il découlait des constatations de la cour d’appel que, pour statuer sur les demandes contractuelles, il était nécessaire à la juridiction saisie « de se prononcer sur la titularité des droits revendiqués par la société TSE ».
Il résulte de cet arrêt que la juridiction appelée à se prononcer sur la compétence doit, pour cela, examiner, au-delà du ou des fondements juridiques explicitement invoqués par les parties, l’objet du litige tel qu’il résulte de l’ensemble de leurs écritures. Si celui-ci, bien que les demandes soient fondées exclusivement sur le droit commun des contrats, implique l’examen de règles du droit spécial de la propriété littéraire et artistique, alors il relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
Cette solution appelle trois brèves séries d’observations : tout d’abord, on relèvera qu’elle est en substance identique à celle retenue par la Chambre commerciale en matière de propriété industrielle ; ensuite, il convient d’en apprécier la pertinence et la portée ; enfin, on en envisagera l’application dans l’hypothèse où la demande n’est plus fondée sur le droit des contrats mais sur la responsabilité civile de droit commun : y a-t-il place, dans ce cas également, pour la compétence exclusive des tribunaux de grande instance ?
I – L’application d’un critère de compétence identique pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle
Ce n’est pas tout à fait la première fois que la Cour de cassation se prononce sur le domaine de la compétence exclusive en matière de propriété littéraire et artistique. Dans un arrêt de 2010, relatif à un litige opposant la société Warner Bros Entertainment, titulaire de droits de marque et de droits d’auteur sur des personnages, à l’un de ses licenciés, qui contestait la résiliation par Warner Bros du contrat de licence, la chambre commerciale avait censuré pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui, sur contredit, avait confirmé la compétence exclusive du tribunal de grande instance, au motif qu’il aurait dû, pour cela, « rechercher si les prétentions (du licencié) portaient sur l’application de dispositions relevant du droit des marques ou du droit d’auteur »(6).
Mais cette motivation était elliptique, les hypothèses ainsi visées par la chambre commerciale n’étant pas aisées à discerner. Néanmoins, sa jurisprudence antérieure comme postérieure permet d’y voir un peu plus clair.
D’une part, elle a jugé, dans des litiges de nature contractuelle mais où l’une des parties au moins était titulaire d’un droit de marque(7), d’un brevet(8), ou même d’un certificat d’obtention végétale(9), que la compétence exclusive du tribunal de grande instance, édictée en des termes identiques pour chacun de ces droits, ne jouait pas dès lors que le litige, tel que déterminé par les parties, n’impliquait pas d’apprécier « l’existence d’une contrefaçon », ou « l’examen de l’existence ou la méconnaissance » du droit de propriété intellectuelle en cause.
D’autre part et surtout, dans un litige récent relatif à l’exécution d’un accord de coexistence entre deux titulaires de marques, la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir admis la compétence du tribunal de grande instance au détriment de celle du tribunal de commerce, après avoir relevé que les droits de marque revendiqués étaient contestés, en sorte que l’action tendant à l’exécution forcée du contrat supposait, « pour déterminer les obligations contractuelles (de l’une des parties) et ses éventuels manquements, de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit des marques ».
La logique et la formule sont identiques à celles de l’arrêt rapporté, en sorte qu’il y a convergence exacte des solutions entre la chambre commerciale et la 1re chambre civile, et entre la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique, ce qui est heureux puisque les textes en cause sont rédigés dans les mêmes termes et répondent à la même ratio legis.
On peut résumer ainsi la solution de la Cour de cassation : le litige, bien que fondé sur le droit commun des contrats, relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance si, pour le trancher, la juridiction doit statuer sur des questions impliquant des règles du droit spécial de la propriété intellectuelle. Ce peut être le cas, notamment, si elle est conduite à se prononcer sur la titularité d’un droit intellectuel, mais on peut aussi imaginer que soit en débat l’existence même d’un tel droit, ou encore des règles du droit spécial des contrats d’auteur. A l’inverse, le litige ne relèvera pas de la compétence exclusive si sa résolution n’impose pas la mise en cause du droit spécial.
Que penser de cette solution ?
II – L’appréciation du critère de compétence adopté par la Cour de cassation
La solution de la Haute juridiction repose sur un critère d’ordre substantiel plutôt que formel : il faut, au-delà du fondement juridique expressément invoqué par les parties, apprécier in concreto si le litige en cause implique, pour sa résolution, l’application de règles du droit spécial de la propriété intellectuelle.
Ce critère respecte, à notre sens, la ratio legis de la compétence édictée par le législateur : on sait, en effet, que cette compétence est fondée sur l’idée que le droit spécial de la propriété intellectuelle est une matière d’une « technicité particulière », qu’il convient de réserver non seulement aux tribunaux de grande instance mais, parmi eux, à certains tribunaux seulement, dotés de chambres réputées spécialisées.
Dès lors, il paraît légitime que les litiges imposant aux juges de manier les règles de ce droit spécial relèvent de la compétence exclusive de ces tribunaux, même si ces règles n’ont pas été expressément invoquées par les parties dans leurs écritures.
L’hypothèse ainsi visée est rendue possible, à notre sens, par la combinaison de deux principes de base du procès civil, énoncés respectivement aux articles 4 et 12 du Code de procédure civile : si l’objet du litige est défini par les écritures des parties (art. 4), le juge doit, quant à lui, trancher ce litige en fonction des règles qui lui sont applicables, le cas échéant en restituant aux faits leur exacte qualification, sans être tenu par celle proposée par les parties (art. 12).
De là vient qu’un litige dans lequel les prétentions des parties sont formellement fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun puisse néanmoins « mettre en cause » les règles de la propriété intellectuelle. En l’espèce, on comprend que la société TSE soutenait, dans ses écritures, que la stipulation contractuelle lui ouvrant droit à redevances sur les exploitations à l’étranger avait pour cause sa qualité de copropriétaire des droits d’auteur afférents au format télévisé. Certes, elle demandait seulement que cette qualité de copropriétaire soit « constatée », mais la défenderesse contestait, elle, cette qualité, prétendant être seule titulaire des droits afférents au format (ce qui, dans son esprit, permettait d’écarter la prétention de la société TSE).
En d’autres termes, si, sur le plan des fondements juridiques invoqués, les parties avaient situé le litige sur le terrain exclusivement contractuel, leur argumentation le plaçait également sur celui du droit spécial de la propriété littéraire et artistique. Les juges, dès lors, tenus de répondre aux arguments des parties et d’appliquer au litige les qualifications pertinentes, devaient, pour le résoudre, statuer sur la question de la titularité des droits afférents au format de l’émission.
On observera néanmoins que statuer sur la titularité, en l’occurrence d’un droit d’auteur, n’implique pas dans tous les cas de manier les règles spéciales de la propriété littéraire et artistique. Si, en effet, dans certaines situations, il faudra manier les règles du CPI relatives à la titularité originaire du droit (et donc, le cas échéant, à la qualification de l’œuvre), ou encore les règles de ce code relatives à la transmission de droits, dans d’autres hypothèses, la titularité pourra relever du champ purement contractuel : ce sera le cas, par exemple, dans un litige entre sous exploitants, où les droits de chacun ne sont déterminés que par le ou les contrats, sans que les règles spéciales relatives aux contrats de cession de droits d’auteur soient applicables, conformément à la jurisprudence dite «Perrier».
C’est dire que le lien automatique que semble faire la Cour de cassation, dans l’arrêt rapporté, entre détermination de la titularité des droits et application des règles spéciales de la propriété littéraire et artistique, application qui, selon elle, conditionne la compétence exclusive, n’est pas si évident qu’il y paraît de prime abord.
Un arrêt ultérieur viendra sans doute préciser ce point. Quoi qu’il en soit, il nous semble légitime de considérer, compte tenu de la ratio legis de la règle en cause, que c’est uniquement si la résolution du litige rend nécessaire d’appliquer le droit spécial de la propriété intellectuelle, que la compétence exclusive du tribunal de grande instance doit être admise.
Cette solution est-elle transposable à l’hypothèse où les plaideurs se sont placés non plus sur le terrain du droit des contrats, mais sur celui de la responsabilité civile délictuelle de droit commun ?
III – Responsabilité délictuelle de droit commun et compétence exclusive
De prime abord, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on peut penser la solution commentée parfaitement transposable à l’hypothèse où les parties invoquent non plus la responsabilité contractuelle, mais la responsabilité délictuelle de droit commun. C’est l’hypothèse où les demandes seraient uniquement fondées sur l’article 1240 du code civil, mais impliqueraient de statuer sur une question « mettant en cause » des règles du droit spécial de la propriété intellectuelle.
À notre connaissance, la Cour de cassation ne s’est jamais prononcée sur cette hypothèse en matière de propriété littéraire et artistique. En revanche, elle l’a fait de longue date en matière de propriété industrielle et cela bien avant de se prononcer sur le cas d’un litige de nature contractuelle.
Sans entrer dans le détail de l’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale en la matière, on relèvera qu’elle a, un temps, appliqué une solution très voisine, sinon identique, à celle de l’arrêt rapporté en matière contractuelle. Dans deux arrêts, elle a effet jugé que, bien que la demande soit fondée sur la seule responsabilité civile de droit commun (action en concurrence déloyale et parasitaire), elle impliquait « l’examen des droits respectifs des parties » sur les dénominations en présence et donc « l’existence d’une contrefaçon ou d’imitation » de marque, ou ce qui exprime la même idée, elle imposait à la juridiction saisie d’apprécier les droits (de marque) du défendeur sur le signe litigieux. Dans les deux cas, la chambre commerciale en déduisait que le litige relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
Mais, plus récemment, dans deux arrêts jumeaux publiés au Bulletin, la chambre commerciale a adopté une position qui peut s’interpréter comme beaucoup plus restrictive.
Dans la première affaire, où le titulaire d’un brevet avait agi sur le seul fondement de la concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, pour voir cesser la commercialisation de produits imitant les siens, elle a approuvé la cour d’appel d’avoir, sur contredit, écarté la compétence exclusive du tribunal de grande instance au profit de celle du tribunal de commerce, au motif que la demande n’était fondée que sur les actes précités de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, « ce qui n’impliquait aucun examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à un brevet ». Certes, ce motif peut se lire comme lié aux circonstances propres au litige : la demande, en l’espèce, n’impliquait pas un tel examen, ce qui ne préjugerait pas d’autres cas où une demande fondée sur la responsabilité civile de droit commun nécessiterait au contraire d’examiner l’existence ou la méconnaissance d’un droit de propriété intellectuelle. Dans cette interprétation, cet arrêt ne ferait qu’appliquer la même solution que les décisions antérieures citées ci-avant.
Mais, il peut aussi être lu, de manière plus radicale, comme signifiant que par sa nature même, la demande fondée sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire n’impliquait pas l’analyse de l’existence ou la méconnaissance d’un droit intellectuel. Dans cette seconde interprétation, la compétence exclusive du tribunal de grande instance serait toujours exclue lorsque la demande est fondée exclusivement sur la responsabilité civile de droit commun.
Dans la seconde affaire, où le demandeur agissait exclusivement sur le fondement de la concurrence déloyale (et donc de la responsabilité civile de droit commun), tout en faisant état à plusieurs reprises de l’existence d’un brevet sur le produit qu’il produisait, mais sans prétendre à la contrefaçon dudit brevet, elle approuve la cour d’appel d’avoir ainsi « fait ressortir que l’action au fond n’était pas relative à des droits de brevets » et d’en avoir déduit que la compétence du tribunal de grande instance devait être écartée au profit de celle du tribunal de commerce. À lire attentivement ces motifs, il semble bien que, pour la chambre commerciale, l’action fondée uniquement sur des actes concurrence déloyale exclut, par nature, qu’elle requiert de la juridiction saisie d’examiner des droits de propriété intellectuelle et donc d’appliquer des règles du droit spécial.
En d’autres termes, on peut soutenir, à la lecture de ces deux décisions, que la chambre commerciale entend désormais tracer une frontière nette entre l’action fondée sur la seule responsabilité civile (action en concurrence déloyale et/ou en détournement de savoir-faire), qui ne met pas en jeu des droits de propriété intellectuelle et relève à ce titre du droit commun, et l’action en contrefaçon, qui relève de la compétence spéciale. Ce faisant, elle ne ferait que revenir à sa jurisprudence antérieure en matière de brevets, qui distinguait clairement, pour l’application de la règle de compétence, l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon « les fondements et les conditions d’exercice » de ces deux actions étant, selon elle, « différents ».
Il y aurait donc une asymétrie entre les actions en responsabilité contractuelle, qui peuvent nécessiter de statuer sur des questions mettant en cause le droit de la propriété intellectuelle et, pour cette raison, sont susceptibles de relever de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, et les actions en responsabilité civile délictuelle qui, en raison de leur nature même, ne pourraient mettre en cause des règles du droit spécial et ne relèveraient donc pas de cette compétence exclusive. Cette asymétrie, qui peut a priori surprendre, nous paraît en réalité légitime. En toute rigueur, au contraire de l’action en responsabilité contractuelle, l’action fondée exclusivement sur la responsabilité civile de droit commun et, en particulier une action en concurrence déloyale ou parasitaire, n’implique pas d’apprécier l’existence, la titularité ou la méconnaissance d’un droit de propriété intellectuelle, ni même n’est de nature à affecter indirectement un tel droit. Par hypothèse, en fondant sa demande uniquement sur la responsabilité délictuelle, le demandeur a choisi de ne pas invoquer de droit de propriété intellectuelle. Le fondement de l’action, son objet, ses conditions d’exercice, diffèrent d’une action fondée sur un tel droit.
La solution vaut logiquement, selon nous, quel que soit le droit de propriété intellectuelle en cause, et donc aussi bien pour la propriété littéraire et artistique que pour la propriété industrielle.
Souhaitons, en tout cas, que la Cour de cassation se prononce clairement sur ce point dans un prochain litige et lève ainsi tout doute, au bénéfice des plaideurs, sur l’exact domaine de la compétence exclusive en notre matière.
V.V.




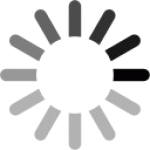
 S'abonner à Legipresse
S'abonner à Legipresse Feuilleter le dernier numéro
Feuilleter le dernier numéro