(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Recherche
(auteur, réf. de texte ou de décision…)
Enews Legipresse
Le club Légipresse
Vidéos
L'anonymisation des décisions de justice et la perte de sens
La mise à disposition du public des décisions de justice sous forme électronique, ou open data, a été initiée en 2016 avec la loi pour une République numérique, puis modifiée par la loi du 23 mars 2019, qui impose d’occulter les noms et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers. Le rapport sur « l’évolution de l’open data des décisions de justice », rendu au garde des Sceaux le 11 juillet 2025 va plus loin, en proposant l’occultation des noms et prénoms des magistrats, membres du greffe et avocats ainsi que de la dénomination sociale des entreprises. Au risque de réduire le principe de publicité de la justice et d’exemplarité de la sanction.
« Appuyez-vous toujours sur les principes, ils finiront bien par céder ». Cet aphorisme de Talleyrand illustre assez bien le travail de sape que peuvent mener les algorithmes d'occultation de tout nom propre dans les décisions de justice communiquées au public via l'open data.
Cette ouverture de la jurisprudence au public, voulue par le législateur en 2016 dans sa loi au titre emphatique de « République numérique », s'est accompagnée d'un principe d'occultation des noms des parties, initié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et qui ne fait que gagner du terrain depuis dix ans (v. la loi du 23 mars 2019)(1), le droit subjectif à la vie privée et à la protection des données devenant un droit objectif et impératif, au grand dam de la doctrine(2) et des praticiens. Ce, alors même que l'action en justice est un acte de la vie publique qui emporte, par essence, publicité(3).
Ainsi, reprend-on d'une main ce que l'on a accordé de l'autre au nom de la transparence(4), l'occultation venant réduire la mémoire vive que l'open data devait garantir au public et aux générations futures dès lors que « la numérisation doit servir la mémoire du droit, pas l'effacer »(5).
L'allégorie de la Justice, aveuglée par son bandeau d'impartialité, vient donc sabrer de son glaive l'intelligibilité de ses décisions et, ainsi, la publicité de son œuvre.
Le rapport sur l'évolution de l'open data des décisions de justice, rendu au ministre du même nom en juillet 2025(6), est une parfaite illustration de cette tendance à réduire le principe de publicité de la justice et d'exemplarité de la sanction.
Ledit rapport nous explique qu'il ne s'agit pas de « remettre en cause les objectifs de l'open data des décisions de justice » et qu'il faut y voir « l'expression de la pleine maturité de la gouvernance de ce dispositif » qui « contribue aux progrès d'une République numérique ».
L'examen des propositions qui visent à réformer l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire permet de douter de ces propos, dont l'emphase n'a d'égale que la relativité.
I - Érosion du principe de publicité de la justice et extension des champs d'occultation
Le ministre souhaitait une réflexion sur « le périmètre des données occultées ». Son vœu est pleinement exaucé quant à l'extension dudit périmètre. Cela illustre une décadence du principe de publicité de la justice en France dans l'oubli de la pratique de la Cour européenne.
A - Extension du champ d'occultation au risque de dévitaliser la jurisprudence
Le groupe de travail propose d'amender l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire et d'occulter les noms et prénoms des personnes physiques (proposition 1), la dénomination sociale des sociétés (proposition 2)(7), les adresses et les localités ainsi que les dates relatives à l'état des personnes et les motifs de la décision lorsque rendue en chambre du conseil (proposition 3). À cela s'ajoute « l'occultation complémentaire de tout élément dont la divulgation est de nature à porter atteinte non seulement à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes, mais aussi au secret en matière industrielle ou commerciale lorsqu'il s'agit d'entreprises, ainsi que d'autres secrets légalement protégés ». Il est suggéré que ce régime soit également appliqué aux demandes de copie au greffe par des tiers(8). Les deux voies d'accès aux décisions juridictionnelles (copie individuelle au tiers, open data) verraient donc leur régime unifié alors même que leur finalité est distincte : principe de publicité pour la communication au tiers, principe de sécurité juridique par la diffusion de la jurisprudence pour la mise à disposition du public(9).
Que reste-t-il dès lors d'intelligible dans une décision ultra-censurée ? Quelle mémoire laissera-t-on aux générations futures de juristes ?
En pratique, le logiciel de pseudonymisation des décisions de justice faisait déjà ce travail de censure depuis la (regrettable) loi du 23 mars 2019, mais il restait le nom des magistrats, du greffier et des avocats. Tous les autres noms étaient occultés, ce qui générait un « aimable surréalisme » comme le relevait Michel Vivant. Exit dès lors l'évocation de Delacroix ou du maréchal Pétain qui étaient pseudonymisés alors même qu'ils étaient au centre de la motivation et n'étaient, bien sûr, pas partie au procès.
B - La décadence française du principe de publicité de la justice dans l'oubli de la pratique de la Cour européenne
Le rapport nous indique qu'il convient de poursuivre le caviardage, au constat de la mise en cause des institutions, notamment de la justice, et du risque de profilage. La critique des décisions faisant figurer les noms de personnels de justice créerait chez eux « un sentiment d'insécurité ».
On observera que, depuis l'Ancien Régime, l'adage veut que « Dieu nous garde de l'équité des Parlements », et que cette défiance est immémoriale dès lors que l'on donne le nom d'une vertu à une administration.
Pour la majorité des auteurs du rapport, sans que l'on ait connaissance du ou des dissidents, « la transparence de la justice, sa reddition des comptes, n'ont pas pris naissance en 2019, et elles ne disparaîtront pas si le nom des magistrats n'est plus mentionné dans les décisions publiées en données ouvertes ». Pour justifier sa position, le rapport soutient qu'il convient de « ne pas confondre la publicité dans laquelle se déroule le procès et interviennent ses différents acteurs, et la publication des décisions de justice opérée par l'open data, qui est postérieure à la fin du procès ».
C'est oublier que les magistrats ne sont que la bouche de la loi qu'ils articulent à des faits d'espèce (d'où l'importance des parties en cause et du contexte), qu'ils rendent leur décision au nom du peuple français (COJ, art. L. 111-1) et que ce dernier ne peut rentrer tout entier dans une salle d'audience.
Dès lors, ledit peuple a droit de savoir qui l'on juge et par qui. La justice servant également l'exemplarité, l'adage britannique nous rappelle que « Justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done ».
On retrouve ici la tare française du secret du délibéré qui vise à ne pas assumer personnellement la responsabilité de la décision de justice. En ces temps de disparition de la collégialité au profit du juge unique, la disparition du nom du juge permettra d'aboutir au même résultat.
Cette pratique française est contraire à la solution retenue par la Cour européenne des droits de l'homme, qui publie les avis dissidents et nomme ses juges. Quant aux parties, en application des articles 33 et 47 du règlement de la Cour, les instructions pratiques de la Cour rappellent que « toutes les informations soumises en rapport avec une requête, que ce soit dans le cadre de la procédure écrite ou dans celui de la procédure orale, y compris les informations au sujet du requérant ou de tiers, sont accessibles au public. / Les parties doivent également savoir que les exposés des faits, les décisions et les arrêts de la Cour sont normalement publiés dans Hudoc sur le site internet de la Cour (art. 78 du règlement) ».
Le principe est donc la publicité et l'occultation, l'exception, sur demande d'une des parties, soumise à l'appréciation de la Cour : « Tout requérant qui souhaite conserver l'anonymat doit en faire la demande au moment où il remplit le formulaire de requête ou aussitôt que possible par la suite. Dans un cas comme dans l'autre, il doit exposer les motifs de sa demande et préciser l'impact qu'une divulgation de son identité pourrait avoir sur lui ».
On peut ainsi rejoindre l'observation de Laurent Richer, lors d'un colloque édifiant sur la communication des décisions du juge administratif, se demandant « si la menace pour la vie privée n'a pas été exagérée [et] d'autre part, si des solutions moins radicales, à chercher dans la mise en place de filtres au stade du traitement des données, n'auraient pas été concevables ».
II - Finalité de l'occultation et sens du droit
Les finalités poursuivies par l'occultation des décisions de justice apparaissent difficilement atteignables et elles viennent poser en postulat impératif des droits subjectifs qui échappent ainsi à leurs titulaires. Ce constat peut inviter à restaurer une cohérence normative pour redonner sens et humanité à la jurisprudence.
A - Les finalités poursuivies par l'occultation : lutte contre le profilage et affirmation du monopole de la Cour de cassation sur l'open data
Le risque de profilage est invoqué pour occulter le nom des magistrats.
Pourtant, ce profilage est d'ores et déjà interdit, depuis la loi du 23 mars 2019, par l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, qui dispose : « Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ».
Toutefois, rien n'interdira à l'une des parties au procès, celle-ci disposant d'une décision vierge de toute occultation (quel trésor !), de publier le PDF de la décision intégrale sur les réseaux sociaux en application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ou via un site internet localisé aux États-Unis ou dans tout autre État ne connaissant pas les pratiques d'occultation judiciaire. On rappellera à ce titre que les bases de données judiciaires américaines n'occultent pas le nom des parties et que le Royaume-Uni, à l'instar de la Cour européenne, permettra non seulement l'accès du public à une décision non occultée mais à l'entier dossier judiciaire.
De même, la pratique du « name and shame » peut amener une association à acheter de l'espace publicitaire afin d'assurer la publicité que la Justice ne veut plus assumer pour ne pas créer un « casier judiciaire virtuel ».
On rappellera à ce titre que l'occultation ne concerne que la diffusion numérique, ce qui redonne toute sa valeur à la publication papier qui demeure hors champ du régime de censure, comme l'a reconnu la CNIL et comme cela ressort des termes de l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire visant la « forme électronique ».
Parallèlement à ce régime de la page blanche pour l'open data gratuit, la proposition 5 suggère d'instituer un second flux de « décisions de justice intègres ou plus intègres, c'est-à-dire dans leur rédaction indemne de tout ou partie des occultations dont elles ont pu faire l'objet en application de l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire », à la condition de signer une convention avec la Cour de cassation (qui se réserve ainsi le monopole de négociation au détriment de la Direction de l'information légale et administrative en charge de Legifrance) qui fixera « les garanties entourant la réutilisation des décisions, la diffusion de décision à des tiers, et la préservation des secrets légalement protégés auxquels elles pourraient donner accès». Et la proposition d'indiquer que les conventions « précise[ro]nt également le montant et les modalités du paiement à la charge des utilisateurs pour le service qui leur a[ura] été rendu ».
Peu importe la rupture d'égalité dont on nous dira qu'elle ne vaut qu'entre égaux. L'important est que l'État appauvri perçoive sa dîme et que la Cour de cassation conserve son monopole tel qu'affirmé par l'article R. 111-10 du code de l'organisation judiciaire depuis le décret du 29 juin 2020.
B - Restaurer une cohérence normative pour redonner sens et humanité à la jurisprudence
La pratique de demande d'anonymat mise en œuvre par la Cour européenne des droits de l'homme apparaît garante d'une cohérence normative, dans le respect du principe de publicité de la justice et de droit à l'information qui oblige à une intelligibilité du droit prétorien.
Dès lors que le droit à la vie privée et le droit des données personnelles sont des droits subjectifs, il est cohérent qu'ils aient à être invoqués par leurs titulaires, de façon légitime, pour fonder l'occultation qui doit demeurer une exception au principe de publicité de la justice.
Or l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire pose l'occultation en postulat. Pourtant, aucun de ces deux droits n'est absolu et chacun doit pouvoir laisser place au droit à l'information sauf exception appréciée strictement par la juridiction.
Il est dès lors regrettable que la quasi-totalité des organisations du personnel judiciaire, à l'exception du Syndicat de la magistrature et des conseillers prud'hommes employeurs, se soit prononcée en faveur de l'occultation, en contradiction avec le principe posé par l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, et l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Seules les organisations d'avocats se sont prononcées en défaveur de l'occultation, le Conseil national des barreaux ayant malheureusement ajouté que le nom des avocats devait suivre le même régime que celui des magistrats en cas d'occultation, ce que ne manque pas d'exploiter le rapport pour étendre le caviardage.
Quant aux éditeurs juridiques et autre legal techs, la lettre de remise nous indique qu'ils considèrent que l'occultation « n'était pas un enjeu pour leur activité [et] que cela n'emportait pas de conséquences économiques significatives pour leurs productions ».
Il importe pourtant de rappeler que les décisions de justice ne sont que des cas d'espèce dans la déclinaison de la loi. À supprimer les noms propres, on laisse à penser à une règle générale et impersonnelle alors même que la personne des parties et le contexte de la décision ont toutes leur importance. L'article 5 du code civil, héritage de la Révolution et inchangé depuis 1803, rappelle opportunément qu'« il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ».
La décision de justice procède d'un raisonnement articulant le droit aux faits de l'espèce dans un processus alchimique associant la pensée du magistrat et l'argumentation des avocats. Faire disparaître leur nom, c'est nier leur droit à la paternité sur cette œuvre qu'est la décision de justice. « Supprimer le nom des parties, c'est d'abord enlever à la décision son identité », proclame justement Pierre-Yves Gautier.
On invoque une justice humaine mais, paradoxalement, on va faire disparaître le nom des êtres humains auteurs des décisions de justice publiées, rendant par là même la règle impersonnelle et changeant la nature de la jurisprudence qui n'est que déclinaison et non création du droit, ce qui fonde la légitimité de l'autorité judiciaire (Const., art. 64).
Le rapport évoque, par ailleurs, les risques d'identification à raison « des styles rédactionnels » via les techniques de Natural Language Processing (NLP), ce qui pourrait inviter à normaliser le style des jugements pour éviter toute identification.
Dès lors que les noms des magistrats disparaissent, que leur raisonnement et leur style judiciaire se normalisent, pourquoi ne pas les faire disparaître pour de bon et confier le rendu des décisions de justice à des algorithmes qui appliqueront doctement les principes qu'on leur aura fixés, sans préjugés et en toute impartialité ?
En conclusion, on observera que l'avis du justiciable importe peu au groupe de travail de ce rapport inquiétant puisqu'il n'a pas songé à interroger les justiciables usagers, se contentant de l'entre-soi des « gens de robe ».
L'institution judiciaire renforce ainsi la vision corporatiste que peut avoir d'elle le justiciable, et affirme un contrôle administratif a priori sur l'open data accessible, ce qui ne peut qu'encourager la défiance relevée par le rapport.



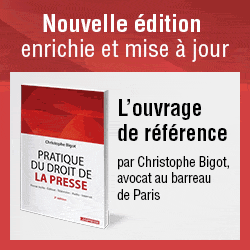
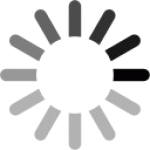
 S'abonner à Legipresse
S'abonner à Legipresse Feuilleter le dernier numéro
Feuilleter le dernier numéro